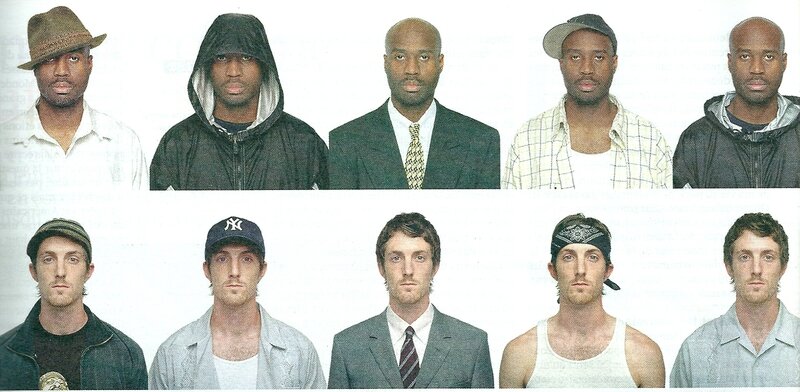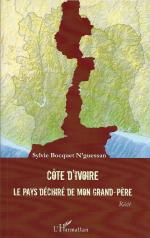Les Ivoiriens veulent émerger de la dictature
Les Ivoiriens veulent émerger de la dictature
Ne nous leurrons pas : les manifestations scolaires d'une ville n'ont jamais fait tomber un régime politique de son piédestal ! Si par cars entiers, les populations de l'intérieur ne descendent pas à Abidjan pour étouffer moralement et politique, durant plusieurs semaines, plusieurs mois, le régime en place, celui-ci attendra chez l'ambassadeur de France que la tempête s'apaise pour refaire surface.
En clair, dans ce combat des populations contre le pouvoir en ce début d'année 2017, il faut éviter de lâcher prise. Si tu tiens l'adversaire à la gorge ou par les couilles et que tu vois que cela diminue ses forces, tu as tout intérêt à ne pas desserrer ton étreinte. Si tu lâches sa gorge et ses couilles, il s'en souviendra et cherchera à te saisir la gorge et les couilles. D'autre part, il faut éviter d'organiser les manifestations les unes à la suite des autres : après les militaires, les fonctionnaires, puis les élèves... Non ! Ce type de combat est voué à l'échec. Bien au contraire, il faut retenir que l'union fait la force. Dès qu'un groupe descend dans les rues, tous les autres doivent en faire autant. Enfin, une manifestation qui se veut un combat sérieux ne s'improvise pas ; elle s'organise, se structure pour durer, pour représenter une vraie force.
Une côte d'Ivoire trop belle pour être vraie
Après un bref séjour en Côte d'Ivoire - plus précisément à Abidjan - une amie française blanche m'a fait le compte rendu suivant : "l'économie semble florissante, de grands travaux sont réalisés et l'on voit de belles voitures, surtout un nombre extraordinaire de 4x4 dans les rues d'Abidjan. En tout cas, tout va bien". A ce discours, j'ai tout simplement répliqué que le trop grand nombre de voitures neuves et surtout de grosses cylindrées comme les 4x4 dans un pays du tiers-monde n'est nullement un signe de richesse mais plutôt le signe qu'il est corrompu. Tous ces véhicules sont des biens mal acquis qui servent de vernis pour cacher la pauvreté mais pas le sous-développement qui est mental avant d'être économique.
En effet, compte tenu des salaires en Côte d'Ivoire, il est impensable qu'une multitude de personnes qui ne sont ni industriels, ni grands commerçants ou grands cultivateurs puissent s'offrir ces véhicules ; surtout quand on sait qu'elles vivent presque toutes dans des appartements ou des maisons qui trahissent la pauvreté de leur condition. On devine donc aisément que celui qui gagne environ 200.000 frcs CFA par mois (environ 600 euros) mais possède un 4x4 ne l'a obtenu que par un service rendu. Quel service, me direz-vous ?
Explication ! Si vous permettez à un riche libanais ou à une entreprise française de mettre la main sur un beau terrain ou un marché qui va lui permettre de prospérer, il vous récompense en vous offrant une belle voiture, un beau 4x4. C'est ce que l'on appelle la corruption ! C'est ainsi que par le passé les Africains ont contribué à la traite négrière. Vous vendez une partie des biens de l'Afrique ou de votre pays à un étranger et celui-ci fait votre richesse personnelle. Tout le monde peut alors vous envier.
Autre exemple : vous êtes à la tête d'un ministère ou d'une société nationale disposant bien entendu d'un budget annuel de fonctionnement. Vous ne faites pas les rénovations, le renouvellement du matériel technique, vous réduisez les missions d'études ainsi que l'amélioration de la qualité des structures sociales devant faire le bonheur des populations ; ce qui dégage suffisamment d'argent pour l'achat de gros 4x4 pour vous et vos proches collaborateurs qui vous deviennent ainsi redevables et gardent le silence. C'est ainsi que l'on ruine un Etat et que les travaux destinés à soulager les populations ne sont jamais réalisés ou sont réalisés à moindre frais et sont donc forcément de moindre qualité.
La réalité et la solution
Pendant ce temps, les populations se plaignent de l'électricité trop cher, la ménagère se plaint des produits importés trop chers, les automobilistes pestent devant le prix de l'essence, le paysan ne sait plus s'il faut qu'il récolte son café ou qu'il le laisse pourrir au regard du prix qu'on lui propose. Et parce que toutes ces personnes vivent avec l'image de leurs parents en prison pour avoir applaudi une autre personne que le président, et sachant qu'elles ne disposent d'aucune tribune pour exprimer leurs besoins pour les faire prendre en compte, la manifestation publique, voire la violence publique devient une solution. Mais pour que cette force publique triomphe, il lui faut se structurer et s'en prendre précisément aux organes économiques qui font la puissance de ce pouvoir et de ses protecteurs étrangers : le café et le cacao ! On ne combat pas une dictature avec des armes démocratiques !
Raphaël ADJOBI